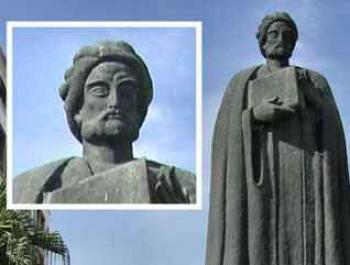L’aggiornamento politique que la jeunesse et l’élite algérienne appelle de ses vœux depuis des années a essayé- faute de mieux- de trouver, depuis quelques mois, un terrain d’expression à travers les actions de rue. La pression mise sur le pouvoir politique par un certain nombre de données endogènes et exogènes l’a amené à imaginer des consultations à travers lesquelles il compte faire passer les réformes politiques. Assurément, les consultations menées par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, ont pour vocation première d’absorber le trop-plein de colère et de mécontentement populaire qui s’est basée, à l’origine, sur des revendications sociales. Inéluctablement, la jonction entre le social et le politique devait bien se faire aussi bien pour des raisons d’une dialectique de la dynamique sociale vieille comme le monde, qu’en raison du climat régional plus que tendu et connu communément sous le nom de Printemps arabe.
Les différents conflits et tensions marquant le corps de la société vont, tôt ou tard, accoucher d’une réhabilitation du débat politique. Sans doute, la logique de ruse et d’atermoiements des tenants du pouvoir politique, d’une part, et le lourd déficit culturel dont souffre la société d’autre part, vont retarder ce processus. Il demeure que la promotion du politique au rang d’un idéal de civilisation visant à consacrer dans la réalité quotidienne le sens étymologique du mot politique (gestion de la Cité) constituera un degré de développement bien avancé de la société et du pouvoir.
« L’organisation de la vie de la cité obéit à des lois multiples, qui ont pour objectif de codifier le comportement des différentes catégories de citoyens et de leurs dirigeants. Montesquieu, dans l’Esprit des lois, présente cette complexité avec la notion de partage des pouvoirs. Les processus de prise de décision, les relations entre les pouvoirs de nature différente, l’aptitude de la communauté à anticiper, à évaluer, à contrôler, à veiller à ce que chaque membre fasse son devoir et ait ses droits respectés, sont des mécanismes complexes, forgés avec le temps, l’histoire de chaque peuple, et incorporant des influences extérieures. La civilisation qui en résulte est un amalgame subtil, et se conjugue évidemment au pluriel, avec des différences notoires d’une civilisation à une autre », lit-on sur le site du développement durable (www.db-dd.org/)
L’histoire de la pensée politique n’a pas bénéficié des développements qui auraient dû être les siens dans le cours de philosophie de nos lycées. Déjà dans le cours d’histoire, les personnages ayant marqué leur siècle par leur apport en idées ou en tendances artistiques sont injustement marginalisés au profit des rois, des chefs de guerre et des affaires du sérail. Le siècle d’Ibn Khaldoun, le 14e, est connu dans les manuels scolaires algériens comme étant le siècle de la décadence de la civilisation musulmane, période qui préfigurait la chute de Grenade un siècle plus tard. L’auteur des Prolégomènes demeure, chez la plupart des lycéens, méconnu, souvent même ignoré si ce n’est son nom prestigieux. Ce n’est que pure logique lorsqu’on sait que le pérégrin maghrébin a été réhabilité au moyen d’une recherche harassante, par une élite orientaliste européenne, principalement française, qui a pu accéder à ces manuscrits et les traduire. Le père de la sociologie, dont certaines idées se retrouveront plusieurs siècles après sa mort chez des penseurs, théoriciens et philosophes européens (Auguste Comte, Marx, Th. Hobbes, Max Weber,…) n’a pas été prophète en son pays ; tout en sachant que son pays allait de Grenade au Caire, en passant par Tiaret et Bougie.
En tant qu’ensemble de disciplines participant à la préparation des cadres de la nation pour prendre en charge, demain, les questions économiques et sociales du pays, et en tant que domaine faisant partie de la culture de la citoyenneté et de la formation des élites, les sciences humaines sont, à dessein, dévalorisées par les décideurs des pays arabes. C’est, en quelque sorte une conséquence logique- voire même un axe fondamental- du travail de soumission des peuples à la volonté des princes, travail qui exige l’anéantissement de toute pensée critique et de réflexion citoyenne.
L’on raconte que les cours de philosophie ont été arabisés en Tunisie à la suite d’une année de protestations sociales organisées par les étudiants et les ouvriers. N’est-ce pas que c’est fort significatif cette façon d’inhiber la fonction critique et d’éveil d’une discipline importante des sciences humaines ? L’arabisation est, ici, prise comme une mesure de répression.
De même, les autres matières enseignées au collège et au lycée n’ont jamais permis l’accumulation d’un background culturel qui aurait permis à l’étudiant universitaire d’aborder avec assurance les modules plus élaborés qu’on lui présente. Sur ce plan, le seul regard jeté sur l’enseignement de l’histoire et de la géographie nous renseigne amplement sur le désastre pédagogique provoqué dans les sciences humaines. En effet, comment pourra-t-on aborder les thèmes de la gestion de la Cité de la gouvernance, de la représentation politique, de la volonté générale, des élections, de la division internationale du travail, de la genèse et l’évolution des conflits sociaux, des rapports entre la croissance et le développement, de mobilité sociale, du chômage,…etc., lorsque, pendant toute sa scolarité l’élève ou l’étudiant n’a eu droit qu’au ronronnement d’une chronologie à apprendre par cœur qui exclut la société sous toutes ses facettes (luttes d’intérêt, crises économiques, production culturelle,…).
L’école et l’université algériennes ont besoin d’immerger dans la profondeur de la pensée politique telle qu’elle est enseignée dans les autres pays du monde. C’est en revisitant les territoires de la réflexion politique que seront mises à jour les évolutions des systèmes de gouvernement, la marche inexorable des sociétés vers plus de progrès et de liberté et les différents modes de gestion de la cité sur lesquels se base le contrat social. Il ne peut y avoir de culture politique par le seul fait d’adhérer à un parti ou même de le créer.
La réflexion et la pensée politiques ont connu un florissant destin dans l’Antiquité gréco-romaine. ‘’La République’’ de Platon, à elle seule, constitue, pour l’époque considérée, un monument. Au Moye-âge, la pensée politique a souvent subi une confusion avec le mysticisme et la pensée religieuse, phénomène renforcé par les Croisades. C’est avec Ibn Khaldoun qu’un début de pensée rationaliste émergera du bassin méditerranéen.
Un siècle plus tard, un autre méditerranéen d’Italie abordera à sa façon la ‘’science du sérail’’. Machiavel aura profité de toutes les idées qui ont été produites au sujet de la société des classes sociales et du gouvernement pour se lancer dans thème qu’il a serré au maximum autour de la royauté du prince et des relations et enjeux qui se nouent entre eux.
Le siècle des Lumières a pu tirer les leçons des luttes sociales, de la transformation du Clergé des découvertes scientifiques pour annoncer une autre vision qui fait privilégier la notion de représentation politique. Avec Rousseau, naîtra le concept de Contrat social et s’affinera la notion de volonté générale.
Les princes : gouvernance et perversions
Un peu plus d’un siècle après la magistrale ‘’Muqaddima’’ d’Ibn Khaldoun, le monde méditerranéen a produit l’une des premières et inaltérables œuvres de sociologie politique qui allait bouleverser les connaissances en la matière fondées jusque-là davantage sur des bases mystico-théologiques que sur des canons rationnels, comme elle allait jeter les premiers jalons des règles de gouvernement dans leurs rapports dialectiques avec la gestion de la Cité.
Comme le pérégrin andalou, inventeur des notions de ‘’Aâçabia’’ et de ‘’citadinité/bédouinité’’ émises dans une période où le monde islamique plongeait dans une déchéance historique caractérisée par le repli sur soi et la soumission aux puissants du moments, le prince florentin avait connu les délices ouatées du sérail et la méchante ingratitude des décideurs pour qui le diplomate n’aurait été qu’un sous-fifre bon aux missions commandées et dont il fallait se débarrasser dès qu’il manifeste des désirs d’autonomie morale et intellectuelle.
Le parcours du fils du Maghreb était plein de dures péripéties sous les règnes successifs des Hafsides de Tunis, des Abdalwadides de Tlemcen et des Mérinides de Fès. Le parcours du Prince florentin n’en fut pas moins houleux avec les services rendus et les sévices subis sous César Borgia, Louis XII, Maximilien 1e et la dynastie des Médicis.
La réédition des ‘’Oeuvres’’ de Machiavel chez Robert Laffont en 2005, dans la collection ‘’Bouquins’’, fait partie d’une entreprise non seulement de vulgarisation d’un travail accompli dans la difficulté dans les années les moins glorieuses de l’Europe déchirée entre un Moyen-Âge finissant et une Renaissance à peine balbutiante, mais aussi d’une volonté de réhabiliter une pensée moderne souvent mal comprise ou, pire, sciemment dévoyée.
‘’Pour la première fois, les secrets du pouvoir sont révélés au monde’’, fait remarquer l’analyste Philippe Sollers à propos des thèses et écrits de Machiavel.
Nicolo Machiavelli, en italien ; Nicolas Machiavel, en français, est né en 1469. Secrétaire de la seconde chancellerie de Florence, il accomplit plusieurs missions diplomatiques. Après la bataille de Prato (en Toscane, dans la province de Florence) en 1512, les troupes françaises se replièrent et la République de Florence s’effondra. Le retour au pouvoir de la dynastie des Médicis annoncera la disgrâce de Machiavel qui perdra ses fonctions, sera fait prisonnier après avoir été impliqué dans un complot. C’est pendant son exil à Casciano qu’il se mit à écrire l’œuvre de sa vie, celle qui le fera connaître de la postérité ‘’Le Prince’’. Il y écrit aussi un autre livre historique ‘’Discours sur la première période de Tite-Live’’ et une ‘’Histoire de Florence’’.
Ce n’est qu’en 1526, une année avant sa mort et pendant la guerre contre les Impériaux, qu’il reprend des fonctions officielles. Il mourut en 1527, l’année où la dynastie des Médicis fut renversée et la république proclamée.
Sérail, arcanes et commandement
‘’Liberté ! bien précieux et désiré qu’on n’apprécie que lorsqu’on la perdu !’’. Tel est le commencement d’une des dernières odes composées par le poète et humaniste italien Pétrarque quelques années avant qu’il mourût, en 1374, au milieu de la plus effroyable anarchie. Désespéré par la situation sociale et politique régnant en Italie, le poète n’invoquait maintenant que la pitié du ciel en faveur de ce beau pays, de cette chère patrie dont la parole ne pouvait plus guérir les blessures : ‘’Dieu seul était capable de guérir les cœurs et d’arrêter le sang qui coulait à flot sous l’épée de l’étranger’’, écrivait-il.
Les troubles politiques et sociaux des seigneuries de la région de Florence amenèrent Machiavel- qui a pu suivre de près et avec un sens aigu de l’observation les machinations des rouages du pouvoir pour diviser et annihiler toute forme de contestation- à analyser la psychologie et les ambitions des prétendants au pouvoir politique ainsi que les voies qu’ils empruntent pour accéder au pouvoir. Il parvint à cette conclusion, devenue par la force des choses une sorte d’apophtegme : La fin justifie les moyens. Un préfacier français d’une vieille édition du ‘’Prince’’ résume cela dans ‘’une casuistique de l’ambition’’.
Écrire de la politique se ramène ainsi à rédiger un manuel de la réussite.
Dans une lettre datant du 9 avril 1513, il écrit : ‘’Le sort a fait que, ne sachant raisonner ni de l’art de la soie, ni de l’art de la laine, ni de gains, ni de pertes, il me faut ou me taire, ou raisonner des affaires de l’Etat’’. Inventeur de la notion d’Etat au sens moderne, ‘’c’est donc l’Etat, mais l’Etat du Prince et, dans l’Etat, le Prince d’abord qui intéressent Machiavel’’, écrivent Marcel Prélot et Georges Lescuyer dans ‘’Histoire des idées politiques’’ (Dalloz, 1986).
Aimer ou craindre le prince ?
Quelles sont les qualités d’un souverain, appelé indifféremment ‘’prince’’ dans l’ouvrage ? ‘’Vaut-il mieux être aimé que craint, ou craint qu’aimé ?’’ se demande Machiavel. ‘’Je réponds que les deux seraient nécessaires ; mais comme il paraît difficile de les marier ensemble, il est beaucoup plus sûr de se faire craindre qu’aimer, quand on doit renoncer à l’un des deux. Car des hommes on peut dire généralement ceci : ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs (…) Tant que tu soutiens leur intérêt, ils sont tout à toi, ils t’offrent leur sang, leur fortune, leur vie et leurs enfants, pourvu que, comme j’ai dit, que le besoin en soit éloigné ; mais, s’il se rapproche, ils se révoltent. Le prince qui s’est fondé entièrement sur leur parole, s’il n’a pas pris d’autres mesures, se trouve nu et condamné. Les hommes hésitent moins à offenser quelqu’un qui se faire aimer qu’un autre qui se fait craindre ; car le lien de l’amour est filé de reconnaissance : une fibre que les hommes n’hésitent pas à rompre, parce qu’ils sont méchants dès que leur intérêt personnel est en jeu. Mais le lien de la crainte est filé par la peur du châtiment, qui ne les quitte jamais’’.
Comme les résument, dans un souci pédagogique, Prélot et Lescuyer, les idées-forces de Machiavel peuvent se présenter de la façon suivante :
Le sens du réalisme : le Prince tient l’homme pour individuellement pour ce qu’il est, c’est-à-dire pour peu de chose et les hommes collectivement pour ceux qu’ils sont, c’est-à-dire pour moins encore que leur total. Il ne se préoccupe pas de ce qui devrait se faire, mais de ce qui se fait. Il est à l’affût de tout, mais ne croit pas aisément ce qu’on lui raconte, et ne s’effraie pas non plus d’un rien.
L’égoïsme, et aussi l’égotisme : le Prince a appris à ne pas être bon au milieu d’hommes qui sont mauvais. Il pratique le culte et la culture du ‘’moi’’, une gymnastique de la volonté une discipline de la pensée, du sentiment et des nerfs.
Le calcul : le Prince préfère être craint qu’être aimé. Être craint dépend de lui, tandis qu’être aimé dépend des autres.
L’indifférence au bien et au mal : le Prince préfère le bien, mais il se résout au mal s’il y est obligé et il y est souvent contraint. Il en connaît plusieurs qui ont violé la foi jurée, mais qui l’ont emporté sur ceux qui ont respecté leur serment.
L’habileté : la qualité principale du Prince est l’adresse, l’énergie, la résolution et le ressort, car les qualités du Prince exigent une création continuelle, une tension sans relâche vers le but.
La simulation et la dissimulation : le Prince est connaisseur de l’occasion, collaborateur avisé de la Providence, mais aussi corrupteur audacieux de la Fortune, grand amateur de la ruse et grand adorateur de la force.
La grandeur : le Prince est au-dessus du commun. Ce qui l’autorise à échapper à la morale, c’est-à-dire au-dessus de la médiocrité ambiante. Il se situe au-delà du bien et du mal. Cupidité rapacité dol, vol, libertinage, débauche, fourberie, perfidie, trahison, qu’importe, puisque tout cela n’a pas pas à être jugé à la commune mesure des vies privées, mais selon l’idéal d’un Etat à faire ou à maintenir. Pourvu que le Prince arrive au résultat, il n’est pas de moyens qui soient considérés comme honorables.
Machiavel annonce ici l’argument-massue que développeront à volonté des théoriciens et des hommes politiques quelques siècles plus tard : la raison d’Etat, une nation que seul le souverain qui l’énonce est capable de lui donner un contenu et des contours flexibles, bien entendu, au gré des besoins du moment.
Ayant sondé la cupidité et la faiblesse des hommes, l’immoralité- sorte de mal nécessaire pour la fonction de Souverain- et les ambitions infinies du Prince, Machiavel a plus décrit et décrypté une situation que donné une ‘’recette’’ comme l’ont colporté ceux qui ont voulu donner de lui l’image d’un diable. ‘’Étrange destin d’avoir un nom qui devient un adjectif négatif’’, écrit Philippe Sollers dans ‘’Le Monde’’ du 27 septembre 1996.
Rousseau : le nouvel un ordre citoyen
Rousseau a toujours exprimé sa foi dans l’homme : aucun péché originel ne pèse sur lui. Le cœur et la raison lui sont donnés pour faire son bonheur. C’est la société dans sa recherche effrénée de bonheur et de progrès, qui le corrompt en tant qu’individu. Une effarante distorsion semble ainsi irrémédiablement s’installer la tension entre l’état de nature et l’état de culture. Un des symboles du siècle des Lumières, Rousseau est ferment convaincu qu’une société où l’homme exploite son semblable interdit tout rapport véritable entre les individus. Rejetant le messianisme clérical et la confiance aveugle en le progrès technique, il fait de l’homme le centre de gravité de toute recherche et de toute réflexion.
« On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et c’est pour cela que j’écris sur la politique. Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferai, ou me tairais ». Lors de son séjour à Venise en tant que secrétaire de l’ambassadeur de France, Rousseau prend conscience des enjeux de la politique et principalement de la capacité de celle-ci à travailler pour le bonheur des hommes. « J’avais vu que tout tenait radicalement à la politique et que, de quelque façon qu’on s’y prît, aucun peuple ne serait jamais que ce que la nature de son gouvernement le ferait être… », dira-t-il.
Philosophe, écrivain, botaniste, Jean Jacques Rousseau est surtout un des grands symbole du siècle des Lumière qui a précédé les grandes révolutions européennes.
Il fait partie, avec Montesquieu, Voltaire, d’Alembert, Diderot, John Locke,…etc., de cette élite qui a renouvelé la pensée philosophique et politique en s’attaquant aux dogmes de la couronne et des temples.
‘’Le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes’’ (1755) fera de lui un proscrit s’imaginant menacé par des complots. Contre l’enthousiasme des Lumières, sa réflexion récuse les vertus du progrès et accuse la société (développement des connaissances, luxe et puissance) d’avoir dénaturé l’homme, né bon. Son projet de société fondé sur un ‘’Contrat social’’ garantissant la liberté et la sécurité des parties, fait du peuple la source de souveraineté.
La condamnation de son livre ‘’L’Emile’’ en 1762 par le parlement de Paris a obligé Jean Jacques Rousseau à gagner la Suisse.
C’est en 1761 que Rousseau achève et publie ‘’Le Contrat social’’. Il faisait partie d’un grand projet de l’auteur qu’il n’avait pu mener à son terme et qui avait pour titre générique :’’Institutions politiques’’. Le professeur Henri Lemaître écrit à propos de cette œuvre : « A l’origine, le problème de l’autorité politique et de sa légitimité : toute autorité de fait est illégitime, et il n’y a de légitimité que par le droit. Il est donc nécessaire de poser comme postulat que le fondement originel de l’autorité politique est le pacte social, contrat tacite par lequel l’individu échange ses droits naturels contre les garanties que lui assure la communauté ».
Le postulat du contrat social, par lequel l’individu passe de l’état de nature à l’état civil, entraîne logiquement que la société ne puisse être légitimement fondée que sur les deux principes de liberté et d’égalité.
A ce moment, intervient la théorie de la volonté générale, dont la souveraineté est l’exercice, ce qui implique que cette souveraineté ne puisse appartenir qu’au corps politique et doive s’exercer dans le cadre des droits et selon les normes prescrites par la loi, elle-même expression de la volonté générale, les lois particulières variant avec le temps et les lieux, circonstances et conditions dont la considération appartient au législateur.
J. J. Rousseau rend hommage à Montesquieu, ce ‘’beau génie’’ comme il dit dans son livre. Mais, il n’est d’accord avec lui ni sur les conceptions ni sur la méthode. Selon lui, Montesquieu n’a pas pu s’élever jusqu’aux principes dont dépend la perfection idéale et universelle de l’Etat. Le droit politique, qui est aussi pour l’auteur la ‘’science politique’’, est encore à naître. Montesquieu s’et contenté de traiter de ‘’traiter du droit positif des gouvernements établis. Rousseau, quant à lui, entend dire ce qui doit être et non pas ce qui est.
Le sous-titre du livre est plus explicite que son titre ; il s’agit des ‘’Principes du droit public’’. Le destin extraordinaire de l’ouvrage, comparativement à certains traités de l’époque consacrés au même sujet, est dû au fait que Rousseau ait mis dans une œuvre littéraire la substance d’un traité de droit politique.
Avec ‘’l’Emile’’, il s’agit de faire un homme élevé selon les valeurs naturelles et capable de vivre parmi ses semblables. Avec ‘’Le Contrat social’’, il s’agit de donner tout le sentier entier à l’Etat. C’est la confusion de ces deux situations- vouloir obtenir, en même temps, un homme et un citoyen- qui fait le malheur de l’humanité. Le seul espoir réside dans le caractère perfectible de la nature humaine.
Dans l’optique du ‘’Contrat social’’, le citoyen devient une personne qui s’est voué corps et âme à l’Etat de telle façon que l’obéissance aux lois qu’il se donne soit l’expression la plus élevée de sa propre liberté individuelle.
Rousseau imagine donc un modèle normatif qui serait le fondement légitime de toute constitution politique.
Ordre civil
L’entrée en matière, au livre premier, nous donne déjà ‘’l’exposé des motifs’’ et les grandes préoccupations de l’auteur qui ont présidé à l’écriture de son Contrat : « Je veux chercher si, dans l’ordre civil, il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles peuvent être. Je tâcherai d’allier toujours, dans cette recherche, ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisés.
J’entre en matière sans prouver l’importance de mon sujet. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c’est pour cela que j’écris sur la politique. Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais ».
Tout le problème est, dans l’Etat social, de sauver la liberté primitive. Y renoncer serait renoncer à la qualité d’homme, aux droits de l’humanité et, par là même, aux devoirs qu’elle impose. Comment alors, concilier la nécessité d’association et le maintien de la liberté naturelle qui ne peut être aliénée ? Comment concevoir le contrat social de telle façon que l’individu conserve, dans l’état civil, la liberté dont il jouissait dans l’état de nature ? Comment faire que, simultanément, nul n’ait à subir le maître et que nul non plus n’ait le droit d’imposer sa propre volonté à autrui ?
« L’homme est né libre, écrit Rousseau, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question ».
Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir, soutient Rousseau. ‘’Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes’’, écrit-il dans le livre cinq de son ouvrage.
Ces conventions, dégagées sous forme de pacte, fondent la société sur le consentement des individus et substituent légitimement à la liberté naturelle la souveraineté du corps social. ‘’Afin que la pacte social ne soit pas un vain formulaire, ajoute Rousseau, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps’’.
Cette volonté générale est dégagée par la voix de la majorité. ‘’Il n’est pas toujours nécessaire qu’elle soit unanime, mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées’’.
Le souverain qui va déterminer la volonté générale est le corps du peuple.
‘’La théorie politique du Contrat social est donc bien l’analyse du rapport entre la notion du souverain et celle du gouvernement (…) La démocratie directe serait le seul régime qui correspondrait au juste rapport entre le souverain et le gouvernement’’, écrit Michel Coz dans son ‘’Jean Jaques Rousseau’’, éditions Vuibert, 1997. Il ajoute, un peu plus loin :’’Tous les grands réformateurs de la société ont puisé dans Le Contrat social des arguments susceptibles de soutenir leurs projets.
La réflexion sur l’Etat et le citoyen a été toujours été la préoccupation de philosophes, écrivains, hommes politiques, théologiens et anthropologues. Depuis ‘’La République’’ de Platon jusqu’à Gramsci, Raymond Aron, Tournier et Edgar Morin en passant par ‘’Le Manifeste de 1848’’ de Karl Marx, la ‘’Moqeddima’’ d’Ibn Khaldoun et ‘’Le Prince’’ de Machiavel, des efforts et des énergies ont été consacrés à la compréhension de la vie de l’homme dans la cité des modes de gouvernement, de l’exercice de la citoyenneté…etc.
Amar Naït Messaoud