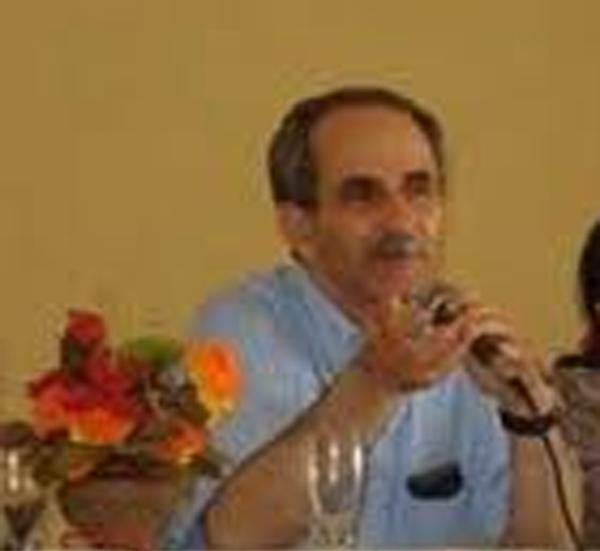“Deux faiblesses qui s’appuient l’une sur l’autre créent une force. Voilà pourquoi la moitié du monde, en s’appuyant contre l’autre moitié, se raffermit”. Léonard de Vinci (1452 – 1519).
Cette contribution est née de la lecture d’une réflexion sur le thème Natural Gas : The fracking fallacy, parue dans la revue Nature en décembre 2014, suivie de deux répliques en janvier intitulées Shale gas : hardly a fallacy et Shale gas : Nuance in output predictions. Preuve que les débats sur les hydrocarbures non conventionnels, sont animés et loin d’être clos, y compris dans les pays où l’innovation technologique tient d’une ressource économique majeure. Par ailleurs, dans sa substance, cette réflexion se nourrit du vécu national qui révèle, on ne peut plus, les velléités de pouvoir latentes et l’illusion d’un jdanovisme économique démesuré dans lequel sont compostés depuis des décennies tous les programmes de développement, pétrifiant ainsi toute forme d’émergence d’intellect critique positif, plus particulièrement, en cette période de recul brutal de la rente pétrolière. C’est à croire que l’on verse dans la cécité et la surdité pour ignorer les préceptes les plus élémentaires qui clament haut et fort les valeurs forces de la réussite : le travail, l’intelligence, l’organisation et le partage du savoir! La sagesse retenue, si c’en est une, est d’écouter les détenteurs de la précellence sortis tout droit de l’école où le fait de dire suffit à satisfaire ceux qui attendent l’acte de faire. Evidemment, le temps est loin où la parole engageait jusqu’à l’honneur d’un individu, c’est plutôt l’ère du discours révulsif et modulable en fonction de l’auditoire et des circonstances. Pour le moins perplexe et inquiétante, cette situation de la décision volatile et inaccomplie nourrit inexorablement le lit de la spéculation et de la prolixité de conjectures cataclysmiques profilant de sombres horizons aux jeunes générations et déteignant négativement sur la vie et le comportement de nos concitoyens innocents, avec entre autres proéminences, la tournure prise par la question du gaz de schiste. Revenons donc à cette ressource inerme enfouie depuis des millions d’années sous nos pieds jusqu’à ce que ses émanations – non celles de son chimisme intrinsèque mais la volupté du smog d’inférences de l’écologisme outrancier – nous inondent et bouleversent nos fibres sensitives et que les conjectures et les élucubrations distillées goulûment par nos chers experts n’embrument un peu plus les esprits les plus humbles et ne provoquent une éclampsie généralisée difficile à stabiliser. Une guerre de positions s’en est alors suivie : ou l’on est pour ou l’on est contre, les positions médianes raisonnées et conciliantes ne semblent pas avoir de place dans cette vision binaire. Cela étant, la réflexion sus citée et ses répliques rédigées par des auteurs avisés illustrent fort bien la vivacité et la controverse des débats aux Etats-Unis, initiateurs du développement du gaz de schiste, non sur l’opportunité de continuer à l’exploiter mais sur le biais des prévisions dans l’évaluation des réserves et la faible performance de la fracturation lors du processus d’extraction. Ils renseignent aussi sur le caractère paradoxal de cette ressource qui est à la fois illusoire, au vu des écarts importants entre les prévisions des réserves potentielles et les réserves prouvées par l’exploration, doublés des contraintes environnementales de la ressource, et prometteur, par sa qualité de nouveau levier énergétique dans l’économie américaine. La controverse est également alimentée par la confusion née d’une distinction entre hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, elle-même issue d’une catégorisation arbitraire en rapport avec l’habitus géologique et, par conséquent, avec les moyens techniques et méthodes à mettre en œuvre pour sa récupération. Mais qu’y-a-t-il de conventionnel ou de non conventionnel dans n’importe quelle ressource naturelle extraite des entrailles de la Terre ? Ce n’est qu’une question de typologie et de classification établies par l’Homme lui-même en fonction de ses standards et de ses préoccupations économiques et environnementales, ou encore, de ce qui s’écarte quelque peu de ses habitudes et routines ? Dès lors, le qualificatif « non conventionnel » porte en lui-même une charge subjective, voire péjorative et instable dans le temps, impliquant une perception négative et une forme de rejet arbitraire de ce qu’il qualifie. En fait, conventionnels ou non, les hydrocarbures proviennent tous des entrailles de la Terre et sont contenus dans des roches. La différence vient des propriétés pétrophysiques de ces dernières et du fait que sous l’action de forces motrices les uns ont quitté la roche mère où ils se sont formés pour être piégés dans une roche réservoir poreuse et perméable, prêts à être pompés par simple forage vertical, tandis que les autres restent confinés dans la roche mère, relativement poreuse mais peu perméable, exigeant des moyens et des méthodes d’extraction plus complexes et plus coûteuses. Dès lors, le développement de toute forme de ressource énergétique comporte des risques et des formes de pollution, le tout est d’en définir les marges admissibles, d’identifier les phases à risque dans les séquences du processus de développement et d’en estimer l’ampleur afin de les limiter et/ou de les circonscrire et les traiter en cas de survenance. Sinon, déjà le fait d’extraire abusivement une ressource est en lui-même une atteinte à l’intégrité environnementale et physique de la Terre, à ses équilibres sous toutes leurs formes. L’exploitation du gaz de schiste ne constitue qu’un recours à une autre forme de ressource naturelle, à l’instar de tant d’autres, en stock dans les entrailles de la Terre dans des conditions géologiques plus complexes, à des profondeurs plus ou moins grandes, par des procédés appropriés perçus a priori comme agressifs et extrêmes pour l’heure actuelle. Mais en réalité, il ne s’agit que du prolongement des techniques utilisées dans le développement des hydrocarbures conventionnels, adaptées aux conditions de gisement de cette ressource. Seuls les déterminants de la rentabilité économique et de l’efficacité énergétique de la nouvelle ressource face à d’autres alternatives existantes ou à acquérir sur le marché international préfigurent la décision de recourir ou non à cette ressource. Le reste relève de la littérature, de la science et de la conviction des investisseurs qui doivent consentir d’énormes efforts à l’endroit des populations et, depuis peu, de l’environnement à travers ce que l’on a convenu d’appeler la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise mais aussi de l’Etat. Telle est donc la problématique duale de la question du gaz de schiste, prise en tenailles entre les tenants de son développement comme défi énergétique majeur et les adeptes d’un écologisme effréné s’y opposant foncièrement au nom d’impacts jugés cataclysmiques. Dès lors, les conséquences de l’exploitation du gaz de schiste sont qualifiées de révolutionnaires par les uns et de désastreuses par les autres alors que la réalité se trouve sans nul doute quelque part entre ces deux extrêmes par l’explicitation de marges admissibles en termes de risques et d’identification de périmètres à interdire à toute opération de ce type s’il y a lieu. En effet, cette énergie « non conventionnelle » peut générer d’importants revenus et, lorsqu’elle est bien produite, ses effets pervers sur l’environnement peuvent être réduits, relativement aux autres énergies fossiles. Il est aussi vrai qu’alternativement, elle semble constituer un frein à l’émergence des énergies renouvelables qui relèvent d’un autre enjeu économique à la fois pour les nouvelles technologies et le secteur énergétique et, mal produite, elle est susceptible de libérer des substances toxiques pour l’hydrosphère, l’atmosphère, et partant, la biosphère ! Ainsi se présente le dilemme de l’équation du développement du gaz de schiste, non seulement dans notre pays mais à l’échelle internationale ; toutefois, une solution intermédiaire combinant revenus et propreté est envisageable avec notamment la mise en place d’instances de contrôle et de régulation indépendantes tout au long du processus de production, de traitement et de transport de cette ressource tant décriée. La question-clé est donc de savoir comment la produire de manière intelligente et raisonnée en réduisant autant que se peut les impacts environnementaux à toutes les échelles, les avantages économiques étant maintenant certains ? A cette question principale se greffent d’autres questions qui nécessitent des réponses et qui sont relatives à la rentabilité de cette nouvelle industrie, aux moyens d’exploration et d’estimation des réserves par une meilleure identification des formations productives et de leurs propriétés et aux marges de risque d’atteintes à l’environnement ? Quels horizons aquifères de la plateforme saharienne peuvent être exploités à l’usage de l’extraction de la ressource et quels sont ceux qui doivent être préservés pour le futur ? Là sont les questions pertinentes que l’on doit débattre et auxquelles on doit apporter des réponses scientifiquement fondées à même d’estomper les inquiétudes des citoyens pour ne pas rester cramponnés à des considérations superficielles, à des guerres de tranchées et à démarches approximatives. Ces considérations montrent combien la question des hydrocarbures non conventionnels est sérieuse et importante en ce sens : (1) qu’elle participe foncièrement à l’avenir énergétique de notre pays à travers la stratégie alternative qu’elle peut offrir avec le déclin des hydrocarbures conventionnels et les retards pris par l’essor des alternatives renouvelables, (2) qu’elle engage un challenge environnemental de taille auquel il va falloir faire face. De ce fait, elle ne peut faire l’objet de débats superficiels mal documentés et mal intentionnés comme elle ne peut être au centre d’une guerre de positions. Elle nécessite explication et compréhension sur la base d’une argumentation scientifiquement fondée et acceptée par toutes les parties prenantes.
Une confusion terminologique porteuse d’une perception négative du gaz de schiste
Ces derniers temps, le paysage médiatique national s’est emballé avec d’intenses débats sur le gaz de schiste, seulement, le terme el-ghaz essakhriy utilisé dans les médias pour le désigner en langue arabe paraît impropre et approximatif combien même il semble de plus en plus consacré. La traduction littérale en français donnerait un curieux agglomérat de « gaz rocheux » avec une contradiction intrinsèque de taille, le gaz est à l’état gazeux comme état de la matière, il ne peut être qualifié par un terme incarnant l’état solide auquel renvoie le terme essakhriy, rocheux, même si, sous certaines conditions de pression et de température, un corps peut épouser divers états ! Ce qui n’est pas le cas de la ressource dont il s’agit ici. Les approximations commencent donc à ce niveau! Nommons les choses comme il se doit ou laissons-les dans l’anonymat ou l’innommable au risque de les affubler d’une charge péjorative ou d’un attribut répulsif! Les dictionnaires de la langue arabe ne sont pas prolifiques en matière de terminologie scientifique dans le domaine de la géologie, surtout quand il s’agit de néologismes relatifs à des concepts des plus modernes. Pour désigner le schiste, les dictionnaires bilingues (français-arabe et anglais-arabe) que nous avons consultés donnent les termes nadhid, ttin safhiy, tafl. Le terme nadhid est le plus récurrent dans ces dictionnaires et semble être le terme approprié tandis que les autres renvoient à des noms communs d’argiles. A la limite, les composés ghaz essakhr ou ghaz ttin essafhiy, ou encore, ghaz ennadhid, paraissent plus corrects et acceptables aux plans syntaxique et sémantique que l’oxymore el ghaz essakhriy. A défaut d’avoir un terme exact traduisant le vocable schiste, encore désigné par le terme essidjil en arabe, on n’a pas trouvé mieux que d’user d’un terme approximatif. Comme si le gaz naturel dit conventionnel n’était pas extrait d’une roche pour qualifier le non conventionnel de rocheux ! Dès lors, la spéculation fait le reste : tout le monde traite du gaz de schiste au nom d’un écologisme sans limites et d’une ardeur subite et inconditionnelle à défendre l’environnement !
(à suivre…) I. A. Z.