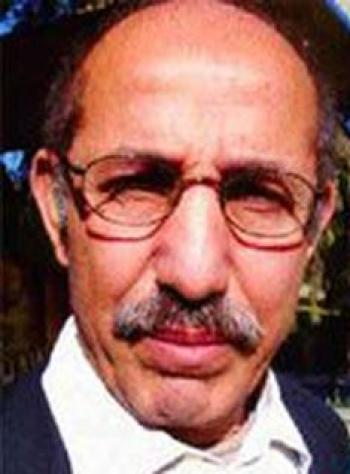La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous évaluer le parcours de la lutte identitaire, depuis les événements du 20 avril 1980 ?
Saïd Khelil : Le 20 avril, c’est notre histoire, une journée qui a vu sortir dans les rues, nos fils et nos filles pour arracher la reconnaissance de notre identité et de notre langue maternelle. Le constat que nous pouvons faire, 33 ans après, c’est qu’il y a certains acquis que nous avons pu arracher, d’un côté et de l’autre, il y a ce qui n’est pas encore acquis. Pour ce qui est de lutte, chaque période a ses propres caractéristiques. Au début des années 80, il n’y avait qu’un seul parti politique et les libertés n’existaient pas. Nous n’avions qu’un seul journal. Mais de nos jours, beaucoup de choses ont changé. Ce qu’il faut savoir, c’est que notre lutte n’est pas encore arrivée à terme et Tamazight n’a pas encore acquis la place qui lui sied. Beaucoup reste à faire pour cela. À la veille du printemps berbère, en 1980, il n’était pas facile de militer et de lutter pour arracher ses droits à sa propre identité. Il suffit d’en voir les résultats. En effet, comme chacun sait, les étudiants qui avaient voulu organiser des manifestations pour la promotion de la langue berbère, avaient prévu des conférences, invitant pour l’occasion Mouloud Mammeri. Mais le pouvoir à cette époque les en a empêchés. Mouloud Mammeri qui était pourtant un grand écrivain, connu et reconnu, a été empêché de tenir sa conférence. C’est pour cette raison que les étudiants sont sortis dans les rues. Et nous, militants du Mouvement Culturel Berbère, étant plus âgés et sans doute un peu plus expérimentés, avions jugé bon de les accompagner et de ne pas les laisser seuls. Et c’est ce qui a mené la plupart d’entre-nous à la prison de Berrouaghia.
33 ans après, on a tendance à dire que la célébration est de plus en plus folklorisée et centrée sur des festivités superficielles. La lutte identitaire a-t-elle perdu de sa verve ?
Je pense qu’il n’y a pas plus difficile que la lutte pour imposer une culture. Parler d’un travail pour la culture, c’est aussi parler de savoir et d’enseignement. On ne doit pas uniquement s’arrêter à la célébration par la danse. Imposer notre culture c’est aussi parler de la langue qu’il faut chercher à transcrire, en plus d’autre investissements encore. Certains ont d’ailleurs montré l’exemple. J’en citerais Mohia, qui a innové dans sa lutte pour la reconnaissance de l’identité et de la langue berbère par la traduction en langue berbère d’œuvres écrites dans d’autres langues. Ce que l’on peut dire et souhaiter en cette occasion, c’est de cueillir le fruit de ce que nous avons semé tout au long de notre parcours. Même si cela demande beaucoup de temps.
Est-ce que le fait que Tamazight soit langue nationale n’a pas un peu amené la lutte identitaire à baisser en intensité?
Dans toute lutte il y a toujours une période où le combat parait beaucoup plus accentué. Nous avons lutté avec ardeur, dans les années 80, et avec la même force dans les années 90. En 2001 aussi, cette lutte a eu pour conséquence le décès de nombreux jeunes. Mais actuellement, je dirais que c’est une période de recul. Mais dans la mémoire collective, dans l’inconscient collectif, je suis sûr que la revendication est toujours présente, elle est toujours la même. Je pense, aussi, que chaque génération enfantera des leaders qui vont émerger afin de reposer le problème.
Pensez-vous que Tamazight a une chance de devenir langue officielle ?
Oui, il faut que Tamazight soit officialisé. Elle s’impose même. Son officialisation voudra dire que nous pourrions nous exprimer en Tamazight dans les institutions de l’état. Cela voudra aussi dire qu’elle aura sa place dans l’école algérienne, que l’état doit lui octroyer un budget bien propre afin de pouvoir l’enseigner de façon adéquate. Nous demandons que Tamazight ait le même statut que l’Arabe. Et c’est là une responsabilité qui nous incombe. Car Tamazight, c’est à ses enfants de la développer et de la rendre florissante. Et cela ne peut commencer que par l’école. «Celui qui veux Tamazight, qu’il apprenne à l’écrire». Il faut qu’on l’écrive, qu’on s’exprime avec et qu’on travaille pour sa promotion, sinon elle risque de disparaître.
Propos recueillis par Tassadit Ch.