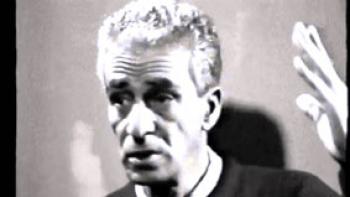«Le vrai poète, même dans un courant progressiste, doit manifester ses désaccords. S’il ne s’exprime pas pleinement, il étouffe. Telle est sa fonction. Il fait sa révolution à l’intérieur de la révolution politique ; il est, au sein de la perturbation, l’éternel perturbateur. Son drame, c’est d’être mis au service d’une lutte révolutionnaire, lui qui ne peut ni ne doit composer avec les apparences d’un jour. Le poète, c’est la révolution à l’état nu, le mouvement même de la vie dans une incessante explosion» K.Y.
Par S. Aït Hamouda
Un poète nait pour l’être, le devenir et le rester. Déjà à peine aussi haut que trois pommes, qu’il se découvre un penchant pour les muses. Aussitôt après pour la révolution, bien avant Nedjma. La prison, il en fait la connaissance alors qu’il avait moins de 16 ans. «Il» c’est Kateb Yacine, romancier et dramaturge visionnaire, considéré grâce à son roman Nedjma comme le fondateur de la littérature algérienne moderne, voire maghrébine. Il était avant tout un poète rebelle. Vingt-six années après sa disparition, il occupe en Algérie «la place du mythe ; comme dans toutes les sociétés, on ne connaît pas forcément son œuvre, mais il est inscrit dans les mentalités et le discours social». Il reste aussi l’une des figures les plus importantes et révélatrices de l’histoire franco-algérienne. Il a été de tous les combats, militant internationaliste pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, pour les droits de la femme, des ouvriers et des paysans. Et surtout pour l’indépendance de son pays. D’ailleurs, il avait participé activement au soulèvement du 8 mai 1945 alors qu’il était lycéen à Sétif. Il a été même incarcéré trois mois durant. Ce qui le marquera sa vie durant. La folie de sa mère, sa première école de rhétorique populaire «un théâtre à elle seule», l’engagement, l’errance, les petits boulots, il avait là la matière première pour devenir un poète rebelle, retord, non conventionnel, pourfendant les sentiers battus. Né en 1929, à Sedrata, d’un père oukil judiciaire, qui versifiait avec impertinence » lorsqu’il sortait ses commentaires » et d’une mère « véritable théâtre en arabe », Kateb Yacine semblait voué par la signification même de son nom patronymique à un destin d’écrivain. Issu d’une lignée de lettrés, l’enfant passe, par décision paternelle, de l’école coranique à l’école française, «dans la gueule du loup» premier trauma linguistique et culturel sur lequel prendra forme la blessure identitaire que l’œuvre en français explore jusqu’aux dernières pages du Polygone étoilé. Romancier et dramaturge, poète avant tout, l’auteur de Nedjma, figure emblématique de la littérature algérienne de langue française, est mort d’une leucémie le 28 octobre 1989 dans un hôpital de Grenoble (France). Quelque mois précédant sa disparition, il avait écrit et monté une pièce «Les bourgeois sans culotte» présenté à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française et reçu le prix national des lettres françaises. « Poésie et révolution ne font qu’un pour Kateb dont la vocation d’écrivain s’est véritablement révélée dans la violence de la répression sanglante de la manifestation du 8 Mai 1945, à Sétif. Arrêté pour y avoir participé le jeune collégien d’alors vit l’expérience carcérale comme épreuve initiatique au poétique et au politique désormais indissolublement liés. De fait, tout semble s’être noué là: l’insurrection dans la langue même de l’étranger qui – au yeux de l’admirateur de Robespierre – a trahi le langage des Lumières, le geste épique pour la libération de la terre et la tragédie personnelle de l’aliénation de la mère rendue folle par la flambée de violence qui a décimé sa famille et l’a privée de son fils, enfin le roman d’amour impossible avec Nedjma, la cousine déjà mariée, rencontrée à Bône au sortir de trois mois de détention et qui, de rêve inaccessible, devient figure majeure élargissant au fil de l’écriture, son envergure poétique aux dimensions d’une nation en gésine. Exclu du collège de Sétif, l’adolescent « largue les amarres » de Bône, où il déserte vite le lycée partagé entre passion amoureuse et exigence révolutionnaire, jusqu’à Paris, où, jeune militant du premier parti nationaliste, le PPA, il donne une conférence, le 24 Mai 1947, sur « l’Emir Abdelkader et l’indépendance de l’Algérie » qui fait retour sur l’histoire de la conquête pour restaurer l’image de l’Emir vaincu en une figure emblématique de résistance . Du même coup, il met ses pas dans les traces poétiques d’un Rimbaud célébrant dans un de ses premiers poèmes en version latine, ce génie de l’autre rive. Introduit dans les milieux littéraires parisiens, il commence à publier dans Les Lettres françaises et Le Mercure de France, tandis qu’à Alger, proche de milieux communistes, il est engagé comme journaliste à Alger républicain où « entre deux dépêches, il griffonne un poème ou reprend un texte en prose qui n’en finit pas. Il l’écrit sur de longues bandes de papier tombées du télétype, qu’il enroule ensuite. Personne ne sait encore que cela s’appellera Nedjma et que le livre fera connaître le nom de Kateb dans le monde entier ». C’est dire que de ses reportages, de la réflexion culturelle qu’il impulse à la une du journal Liberté Alger Républicain en traduisant en marge de l’actualité les poètes errants, les histoires de Djeha, l’œuvre « au versant » porte l’empreinte. En 1950, à la mort du père, il entame pour une vingtaine d’années une vie d’errance en Europe: Ecrivain tout court, écrivain public, écrivain en grève, en exil, en rupture de ban, ainsi va la vie de l’ écrivain errant : Alger – Paris – Milan – Tunis – Bruxelles – Hambourg – Bonn – Stockholm – Bruxelles – Milan – Monterosso – Trieste – Zagreb – Tunis – Berlin – Florence – Paris – Alger – Rome – Nemibo – Moscou – Kislovodsk – Bad Godesberg – Paros – Sédrata – Aïn Ghrour – Bir Bouhouch [3] (Quatrième de couverture du Polygône étoilé). Au gré de ces pérégrinations se fait la gestation douloureuse d’une écriture d’exil qui recompose inlassablement des lambeaux de mémoire. Nedjma « étoile de sang aux origines troubles » en contrepoint de la hantise du mythe ancestral omniprésent, obsède une écriture éruptive. Poèmes disséminés, tragédies inachevées, pages d’histoires… : « Œuvre en fragments » – pour reprendre le titre de l’ouvrage de Jacqueline Arnaud – Nedjma se constitue en matrice éclatée et mouvante des publications essentielles. Ces météorites qui s’aimantent mutuellement par des jeux de reprises se détachent indéfiniment par leurs parcours propres. De l’ambivalence illusoire de Nedjma (1956) à l’éclatement du Polygone étoilé (1966) en passant par l’épreuve de la tragédie, Le Cercle des représailles, où le verbe ancien prend sa revanche, ce circuit ouvert d’une parole en suspens qui remonte à la source de ses déterminations socio-historiques, donne toute son ampleur à la nébuleuse Nedjma. La démystification entreprise dans le Polygone étoilé s’ancre dans une tradition populaire maghrébine vivace qui avait retrouvé dans Le Cercle des représailles (1959) son origine et sa dimension tragiques tout en assumant dans La Poudre d’intelligence (volet central de l’œuvre) l’héritage critique d’une farce contestataire centrée autour de Djeha, héros de contes facétieux. Dès lors, Kateb jette les bases d’un théâtre politique qui s’est poursuivi d’abord en français avec «L’Homme aux sandales de caoutchouc» (1970), puis en arabe dialectal avec «Mohamed prends ta valise» (1971) produit pour l’immigration en France. Déterminante, la rencontre avec un public populaire, celui des opprimés dont il s’est toujours senti solidaire, l’a conduit, lui le Maghrébin errant, à rentrer au pays pour se vouer à l’édification d’un théâtre qui parle et exprime les préoccupations d’un peuple « sans voix ». Nommé directeur du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, le « fou de Nedjma » sillonne alors les chemins de l’Algérie profonde, portant ainsi sur son terrain d’élection une action théâtrale qui pourfend fanatiques et exploiteurs de tous bords et à défendre une culture libre et vivante qui ne brime pas ses racines berbères ni l’émancipation des femmes. «Saout Ennissa» (La Voix des femmes) (1972), «La Guerre de 2000 ans» (1974), «La Palestine trahie» (1977) comme «Le Roi de l’Ouest», participent d’un théâtre de type nouveau qui noue ses racines dans la culture vive du peuple et s’élargit aux dimensions de la planète. À notre époque, disait Kateb, « pour atteindre l’horizon du monde, on doit parler de la Palestine, évoquer le Vietnam en passant par le Maghreb ». Voici ma vie à moi / Rassemblée en poussière / Je vous reviens avec ma gueule / De paladin solitaire / Et je sais que ce soir / Monteront des chants infernaux (…) « Du sang j’en ai partout / Coagulé dans mes souvenirs / Ruisselant dans mes rêves (…) Ô l’assassin de mes chimères : c’est un ange/ Mort dans la mort/ Des choses sanglantes. Cette expression à vif d’une conscience meurtrie porte la hantise du sang qui déborde l’imaginaire et donne la pulsation d’une écriture jaillie de la violence. Seuls antidotes à cette plainte sombrée dans la souffrance, en proie aux tentations suicidaires, d’une part une ironie caustique, un humour jamais en défaut, qui balaient une trop grande complaisance à soi, d’autre part une révolte face à l’injustice d’une histoire absurde qui condamne « les pauvres d’un pays de soleil (…) ceux qui sont morts pour les autres, et pour rien ». « Au commencement était… la mort omniprésente : redondante dans les premiers vers, celle-ci fait entendre d’abord son écho funèbre. « La mémorable » qui désigne la disparue anagrammise la mort et la mère conjointement réunies dans le même souvenir. Cette empreinte indélébile d’une disparition élémentaire gravée aux marches du poème en langue française, s’ étend aux dimensions du gynécée originel (les sœurs) et interdit du même coup tout recours à une parole originelle génératrice d’une reconnaissance de soi, contrecarre toute identification du sujet poétique au père et à sa loi (V.11/17 : « Elle est morte/ La mémorable/ Ses sœurs/ Ne veulent pas qu’elle rajeunisse/ Hélas elles sont nombreuses/ Et toutes/ Elles mourront »). Par l’alchimie du verbe s’opère la métempsychose : dans cette « comme-union », transfusion de sang/sens du Même à l’Autre et inversement, la disparue se ranime, double chimérique qui vampirise une écriture la transportant fugacement au temps de la genèse. Mais, théâtre de la faute originelle et de la malédiction de l’exil, l’illusion édénique n’est restaurée que pour mieux mesurer la perte en altérations successives. Baignée dans une atmosphère aquatique, Nedjma, authentique figure du mixte surgit d’abord dans le cadre d’un jardin par la médiation artistique, au son du luth. S’esquisse là le rêve du Nadhor, Paradis perdu de l’indifférenciation primitive au cœur de la quête romanesque:
Un luth faisait mousser les plaines et les transformait en jardins Noirs comme du sang qui aurait absorbé le solei J’avais Nedjma sous le cœur frais humais des bancs de chair précieuse.
Cette « écriture cannibale » qui fixe et absorbe cette « morte si vive » – tout à la fois figure idéalisée de l’ailleurs et oralité dévorante aux traits féroces de l’ogresse au sang obscur, – coagule ces contradictions initiales en mythe d’ambivalence. Et le fou de Nedjma cristallise autour de « l’Andalouse » la nostalgie d’une mirifique luxuriance poétique, où la puissance du verbe arabe saurait enrichir l’alliage subtil du chant d’Aragon et, autorisant toutes les licences, intégrer l’expérience du présent dans les riches traces d’un héritage culturel ancien : Et les émirs firent des présents au peuple, c’était la fin du Ramadhan / Les matins s’élevaient du plus chaud des collines, une pluie odorante ouvrait le ventre des cactus / Nedjma tenait mon coursier par la brise, greffait des cristaux sur le sable / Je dis Nedjma, le sable est plein de nos empreintes gorgées d’or». Le jour de l’indicible une fois la mort du poète consommée, Kateb Yacine alla à la rencontre de Mustapha Kateb à l’aéroport pour le rapatriement des deux dépouilles qu’accompagnait… Nedjma la vraie, il l’avait, le poète prédit par préscience «Seule Nedjma accompagnait mon corbillard». Aujourd’hui siégeant au comité central des ancêtres, de ceux dont on parle au passé il est plus présent que jamais pour ceux qui l’ont toujours ressenti vivant.
S.A.H